

Le Parisien, le mardi 1 novembre 2022
Yves Jaeglé Envoyé Spécial À Varsovie et Lodz (pologne)
« EXCLUSIF Un violon de 1719, estimé à 10 millions d’euros, volé par les Allemands en Pologne en 1944, pourrait avoir réapparu en France. Une association a été missionnée afin d’en retracer l’histoire et le statut juridique.
C’est une cachette à la Anne Frank, tout au bout d’un couloir, à l’extrémité du Musée national de Varsovie, le Louvre polonais. À l’été 1944, pas d’êtres humains dans cette planque, mais des oeuvres d’art et des instruments de musique de grande valeur, entreposés dans ce recoin perdu pour échapper au pillage des nazis. Cet endroit discret se trouve sous un escalier, dans la salle 19 de l’énorme édifice, et abrite aujourd’hui un cabinet de dessins.
À l’époque, il servait de chapelle. Cet été-là, les combats entre la Résistance polonaise et la Wehrmacht, sous l’oeil passif de l’Armée rouge massée de l’autre côté de la Vistule, s’achèvent par 200 000 morts en deux mois à Varsovie, et l’atmosphère d’apocalypse – 85 % de la ville rasée – est propice à tous les vols. Des soldats allemands trouvent la cachette. Parmi leur butin, un violon stradivarius de 1719, surnommé le Lauterbach, du nom de l’un de ses propriétaires au fil des siècles, d’une valeur estimée à 10 millions d’euros. Il n’a jamais été retrouvé.
Cette pièce d’exception fabriquée par le luthier Antonio Stradivari (1644-1737) pourrait être aujourd’hui en France. L’avocate Corinne Hershkovitch, basée à Paris, chargée du dossier, et spécialiste mondiale des affaires de restitution, a aussi des clients à l’étranger. La confidentialité lui interdit de révéler la nationalité du propriétaire actuel. Ce dernier a missionné son association Musique et Spoliations, fondée en 2017 avec Pascale Bernheim, afin d’enquêter sur le violon en sa possession. Il pourrait être celui que certains Polonais considèrent comme un trésor national culturel. Si Corinne Hershkovitch compte à son actif un grand nombre de peintures spoliées en 1939-1945 et restituées récemment aux héritiers de leurs propriétaires, c’est la première fois qu’elle piste un instrument de musique. « Personne ne fait ce travail en Europe », confie Pascale Bernheim, femme de terrain de leur binôme. C’est elle qui s’est rendue en Pologne, le 24 octobre, pour « rassembler les pièces du puzzle » du Lauterbach.
Un testament qui laisse planer le doute
Nous voici devant la cachette. Il faut s’accroupir. Un parquet en bois hors d’âge, qui n’a pas bougé. Le radiateur a été changé. Pour le reste, cette pièce vide, à l’époque complètement obstruée, n’a pas bougé. Un local à chauffage, où les conservateurs avaient entreposé autant de trésors que possible. Ici l’histoire est passée. « Retracer la vie d’un instrument, c’est rendre hommage aux musiciens qui l’ont eu entre les mains. Un violon de ce niveau, c’est une vibration qui passe dans le corps, une relation charnelle pour les interprètes qui en ont joué », lâche l’experte, qui a travaillé à l’auditorium du Louvre. Elle mène une semaine d’enquête, rendue possible par un financement de la Fondation Sophie Rochas.
Premier impératif : savoir à qui appartient vraiment le stradivarius. La première matinée se passe dans un petit bureau du Musée national de Varsovie à consulter des archives. L’instrument, passé de main en main et de pays en pays depuis 1719, a été acquis en 1901 par Henryk Grohman, industriel polonais richissime de Lodz, et mécène artistique. Un premier certificat confirme l’acte d’achat. Premier mystère de ce « strad » : il n’existe aucune image de lui. En février 1939, Grohman voit sa femme disparaître, puis meurt à son tour en mars à 76 ans. Sans enfants, il a souhaité léguer toutes ses collections au jeune État polonais. Mais s’il évoque dans son testament ses nombreuses oeuvres japonaises et chinoises, il ne mentionne pas le stradivarius. Plus complexe encore : peu après sa mort, ses ayants droit ont fait part d’un projet de legs du violon au musée, mais sous condition que ce dernier crée une fondation pour de jeunes musiciens et qu’un lauréat puisse jouer chaque année sur l’instrument. Un désaccord apparaît avec les responsables de l’époque. Ce document non finalisé n’est même pas signé. Entre-temps, la Wehrmacht a envahi Varsovie.
Première révélation pour Pascale Bernheim : juridiquement, la présence du violon dans la cachette du Muzeum Narodowe est plutôt un dépôt qu’un legs. Pour en savoir plus, l’enquêtrice se rend à Lodz, où se trouve le testament manuscrit original de Henryk Grohman. Dites « Outch », la prononciation correcte, en tout cas pour un Polonais, sinon il ne comprendra jamais que vous parlez de Lodz. Dans ce village du XIX e siècle, devenu lors de la révolution industrielle le Manchester de l’Europe de l’Est, avec ses énormes usines textiles au milieu de la commune, on sent comme rarement ailleurs le parfum d’un continent défunt.
Plongée dans une mer de paperasses
En quelques années, la famille Grohman, l’une de celles qui ont bâti dans cette ville provinciale à deux heures de Varsovie un empire industriel du coton, a tout connu : l’extrême richesse de l’avant-guerre et la grandeur culturelle et musicale d’une cité qui a vu naître Arthur Rubinstein, l’un des plus grands pianistes du XX e siècle, le sauve-qui-peut de 1939-1945, le martyre des juifs, celui aussi d’une nation ravagée, et immédiatement après, le communisme, les nationalisations, les confiscations.
Première étape aux archives de la ville, où se trouve le testament manuscrit du collectionneur. Cette centaine de pages d’actes notariés fait figure de maquis. « Vous essayez de trouver le mot stradivarius. C’est énorme, cette liasse… », soupire la responsable de Musique et Spoliations, qui ne perd pas espoir ni humour en parcourant ces gros dossiers aux papiers jaunis. « Je découvre l’origine de l’expression gratte-papier, sourit-elle. Mais l’enjeu est énorme. » Au bout, une restitution possible du stradivarius à l’État polonais. Mais Grohman ne mentionne toujours nulle part son violon…
Il reste un coup à tenter. Aller chez Henryk, tout simplement. Sa villa est toujours habitée, quelquefois ouverte au public. On quitte ces rues un peu soviétiques pour un quartier de parcs. Une première résidence, presque arrogante de luxe et d’immensité de l’extérieur, apparaît inhabitée. Celle de Ludwik, le père du collectionneur, actuellement en rénovation. En marchant, on dépasse celle du fils sans la voir. Pourtant, l’itinéraire sur le téléphone mentionnait bien cette adresse. Non, ça ne peut pas être cette sorte de squat en briques rouges, les mêmes que celle de l’énorme usine en face, majestueuse ruine sur laquelle poussent à très grande hauteur des arbustes et même un sapin sur une façade lézardée. Elle ne donne plus que sur du vide. Notre interlocuteur polonais appelle la vieille dame qui habite la villa Grohman pour nous remettre dans le bon chemin. Incroyable, c’est bien cette bâtisse.
La porte s’ouvre et nous voilà aspiré comme dans « Alice au pays des merveilles ». Cette antichambre en mosaïques de marbre sous nos pieds. Jadwiga Tryzno, 76 ans, habite là depuis 1993. Avec son mari artiste, mort l’an dernier, elle cherchait un lieu pour y créer un petit musée alternatif de l’imprimerie et d’art contemporain. Un accord est trouvé avec la ville pour investir cette grande maison qui a abrité un jardin d’enfants jusqu’en 1990. L’an dernier, Jadwiga a consacré un petit livre à l’histoire de cette villa. Elle le tend à Pascale Bernheim. En tournant les pages, soudain, une photo du violon. Cris de joie. Enthousiasme de courte durée. La responsable d’association envoie l’image à un expert à Paris qui, en cinq minutes, lui répond que ce n’est pas le bon. Encore raté. Maudit « strad » insaisissable. Dans un salon de musique où trône encore un piano ayant appartenu à Henryk Grohman, la maîtresse de maison nous sert du thé et du whisky. On trinque une fois, deux fois, « Na zdrowie ! » à la grandeur passée.
Pourra-t-on l’entendre un jour en concert ?
À la place des ampoules nues qui tombent des plafonds brillaient autrefois les plus beaux lustres Art déco de la haute société. Ici s’est produit à deux reprises le pianiste Ignacy Paderewski (1860-1941), l’un des grands hommes de l’histoire polonaise, ancien Premier ministre. Vertige. Tout est dans son jus, vide, délabré et sublime. Les ornements influencés par la Sécession viénnoise, le papier peint d’époque désormais couleur sépia. Des chaises contre le mur comme dans une salle de bal. Ces immenses portes en bois d’acajou. Une poignée nous reste dans la main. Beau, mais vermoulu. Des puits de lumière jaillissent des baies vitrées. Ici s’achève un monde et commence une histoire.
Le lendemain, retour à la villa pour rencontrer Pawel Spodenkiewicz, journaliste écrivain âgé de 66 ans, dont l’ouvrage « le Sable de l’Atlantide » évoque la dynastie Grohman. « C’est le sable du temps perdu, celui qui s’incruste dans la peau quand vous revenez de la mer », dit-il joliment. Tout le monde n’a pas cette poésie, mais tous sont aspirés par ce refus d’oublier. Comme Tomasz Golebiewski, membre et imprésario du Grohman Orchestra, qui rend hommage au mécène de Lodz. Attablés dans un restaurant de la ville, on lui lâche bêtement qu’en France, il existerait forcément une photo du violon et mille traces de ce passé brillant. Tomasz s’emporte : « En Pologne, on a eu la pire guerre que les nazis pouvaient faire, ils nous méprisaient si profondément. Et ensuite on a eu le communisme. Alors les archives… » Ainsi Henryk Grohman a-t-il disparu des radars en même temps que son violon, alors que l’Europe était à feu et à sang, et que la guerre froide achèverait de plonger dans la brume un âge d’or de la culture polonaise.
Alors que l’instrument semble ressurgir, comment savoir à qui il appartient ? Corinne Hershkovitch se positionne sur le terrain juridique : « Quel est le titre de propriété qui prévaut ? L’actuel possesseur, de bonne foi, qui ignorait tout de son histoire ? Ou la Pologne pourrait-elle faire valoir des droits ? Ce que l’on a découvert avec le testament, c’est que le musée de Varsovie n’est en réalité jamais devenu propriétaire du stradivarius. »
Mais la diplomatie se mêle souvent au juridique dans ce type d’affaires. Le gouvernement de ce pays de l’Est pourrait donner de la voix : « Reprendre un violon que nous ont volé les Allemands, quelle victoire ce serait ! » nous a lancé avec gourmandise un passionné de musique. Une loi votée en 2021 par la Pologne, qui empêche toute restitution d’une oeuvre à un particulier à partir de trente ans après la spoliation, empêcherait a priori à d’éventuels descendants de faire valoir leurs droits. Mais entre l’État et le propriétaire, un combat d’avocats pourrait s’initier dans un entrelacs de juridictions internationales.
L’enjeu est considérable. Un stradivarius rare a été vendu 15,3 millions de dollars aux enchères à New York en juin dernier. On ignore les motivations du propriétaire, qui a fait expertiser son violon : il existe selon son avocate « une forte présomption » qu’il s’agisse bien du Lauterbach, décrit très précisément dans ses moindres détails en 1913 par l’un des plus grands luthiers européens. En cas de vente, une fois que toutes les zones d’ombre auront été dissipées, qui pourrait l’acheter ? Un collectionneur, une banque, une fondation, un fonds d’investissement… Ces institutions acquièrent des instruments majeurs pour les confier à un soliste exceptionnel.
Ce que peuvent souhaiter les mélomanes, c’est que le « strad » de 1719 ne reste pas muet. Qu’il soit joué en concert. Et si c’était la raison pour laquelle Henryk Grohman ne l’avait pas mentionné dans son legs ? Il est mort sans donner sa dernière volonté, mais son violon muet depuis près de 80 ans, lui, est en train de ressusciter. »
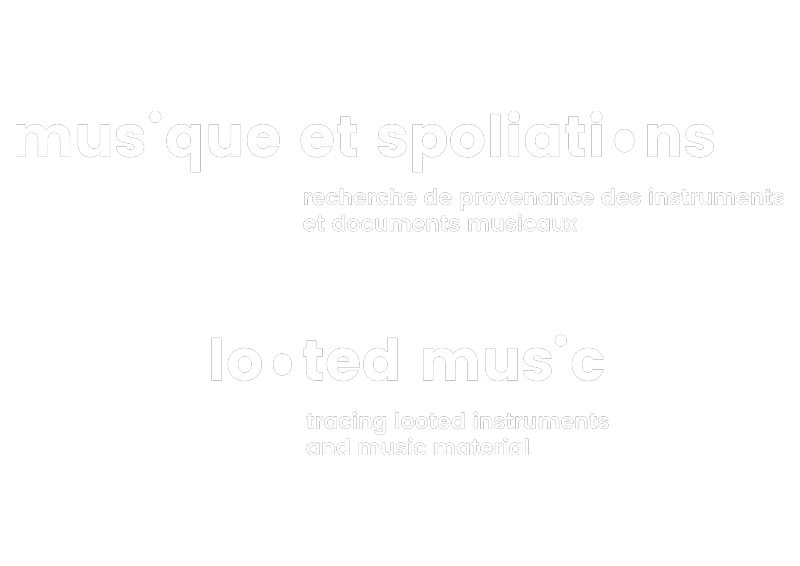

Laisser un commentaire